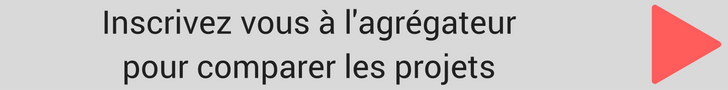Pierre Frécon, investisseur professionnel et fondateur de Docteur Startup, nous donne sa vision sur l’évolution du crowd Equity et du crowd Lending.
Les Finances participatives et les Français
La France est un pays unique sur de nombreux aspects. L’histoire l’a longtemps mis sur le devant de la scène : bénéficiant d’un large empire colonial face aux rivaux britanniques pendant longtemps, puis portée par la révolution industrielle qui la laisse encore 6ème puissance économique mondiale aujourd’hui.
Tout cela pour un pays qui représente à peine 1% de la population mondiale. Un pays qui accorde une place essentielle à la réflexion, la philosophie, la capacité d’abstraction et de raisonnement et paradoxalement donc se tient à une distance prudente de l’argent qui corrompt tout ce qu’il touche.
Nul besoin d’enfiler plus de perles, les réseaux sociaux puis la finance participative, arrivés en France il y a une petite dizaine d’années ne pouvaient s’exprimer ici comme ailleurs.
49% des Français donnent chaque année environ 400€ en moyenne, soit 2 milliards d’euros[1]. Bien sûr, avec un plafond à 530€ pour une réduction fiscale des 2/3 du montant, la subvention de l’Etat est forte mais les Français soutiennent notamment les causes de l’exclusion et l’enfance.
Naturellement, la finance participative s’est développée en France sur ce modèle : rassembler les forces pour soutenir des projets plus importants, à vocation humanitaire.
Et qui dit « humanitaire », dit rapidement « social » et qui dit « social » en France peut dire assez facilement « culturel ». Certains labels émergeaient donc autour du don avec contrepartie, pour la promotion d’artistes nouveaux. My Major Company, surfant sur cette vague émergeait par exemple dès 2007, sur le champ de la musique, avant de se diversifier quelques années plus tard.
Et les Business Angels ?
Quand Wikipedia[2] nous parle de financement participatif, elle évoque deux dynamiques proches ayant sans doute conduit progressivement à cette démarche : la souscription pour la fabrication de la Statue de la Liberté… et les Business Angels.
Business Angels ? Les « Anges des affaires », un oxymore en France mais un terme particulièrement bien trouvé dans la langue de Shakespeare (et qu’on ne traduit donc pas).
En gros, des particuliers qui financent des sociétés en émergence avec leur épargne, y croient avant tout le monde en considérant à la fois des éléments rationnels et émotionnels, nécessaires quand tout reste à bâtir. Premier maillon de la chaîne de financement, ils permettent aux champions de demain d’émerger. Collaboratif ? Précurseur ? Moyens limités ? Tous les ingrédients de la finance participative sont effectivement là…
Ces particuliers qui investiraient au capital de nos start-ups, combien sont-ils ? Eh bien avant le tremblement de terre de la loi TEPA, ils étaient à peine 4.000 en France contre 40.000 en Grande-Bretagne et 400.000 aux Etats-Unis. Ils investissaient au total 60M€ soit la moitié du financement en amorçage en France (environ 120M€ au total)[3].
La loi TEPA (Travail Emploi Pouvoir d’Achat) a prévu dès 2008 une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune conséquente (75% d’abord, bientôt 50%) pour l’investissement au capital de PME européennes. Dès la première année de cette loi, nos particuliers français contribuables / investisseurs devenaient 100.000, investissant 1 milliard d’euros par an de quoi faire blêmir nos voisins anglo-saxons ?
Pas tout à fait. Parce que si nos compatriotes avaient bien compris les tenants et aboutissants fiscaux de tels investissements (et notamment la date limite d’investissement causant une frénésie dans les dernières semaines de mai), actionnaire, notamment d’une société non cotée, qui plus est jeune (et fragile) pour la frange activiste qui s’intéressait aux start-ups, n’est pas une sinécure.
Limites culturelles du modèle, premières solutions
Une action est une dette à durée indéterminée. L’entreprise la contracte auprès de l’actionnaire et n’a pas prévu de la rembourser, mais donne en contrepartie un intéressement aux bénéfices (aléatoires) plutôt qu’un taux d’intérêt en rémunération de l’apport.
Engagé à long terme dans l’avenir de la société, l’actionnaire dispose également d’un droit d’information et d’un droit de vote sur les décisions de fond organisant l’avenir de l’entreprise.
Intellectuellement (et juridiquement, merci au Code Civil), cela se comprend assez bien, mais l’on voit tout de suite qu’actionnaire est un sport de fond, avec son quota de sueurs froides sur le parcours et des responsabilités demandant un minimum de compétences et de disponibilité.
Et ce constat pose un antagonisme fondamental avec la dimension participative du financement que nous traitons ici : un projet clair, compréhensible par tous, auquel beaucoup peuvent s’identifier. Et leur nombre compensera la faiblesse de leurs engagements financiers individuels !
La première réponse, quelque forme qu’elle prenne, réside dans l’intermédiation. On crée une société « holding » (littéralement qui « tient » les titres des actionnaires) qui représente le plus grand nombre, ou l’on structure très clairement les droits et obligations de chacun dans un contrat (statuts, pacte d’actionnaires), ou… etc.
Ces solutions qui existent depuis des années peuvent être très robustes, mais elles ont un coût juridique et administratif élevé, d’autant plus si le nombre d’associés est élevé. Celui-ci se justifie souvent mais il réduit d’autant l’argent effectivement disponible pour aider l’entreprise (environ 5 à 10% du montant disponible, hors frais d’avocats).
En première conclusion, être actionnaire n’est pas donné à tout le monde et si on peut faciliter l’intégration des « participants » comme « actionnaires », ce coût est élevé et lié au nombre de participants, il va donc à l’encontre de l’effet d’échelle proposé par le financement participatif.
Un modèle plus simple et plus adapté : le prêt ?
Où le bât blesse-t-il ici ? Au niveau de la gestion juridique de la qualité d’associé pour des personnes qui ne sont pas prêtes à l’être. Mais l’ont-elles réellement demandé ? Par vraiment non plus.
Au départ, il est probable que les participants ont 1/ une sensibilité émotionnelle au projet d’entreprise présenté, 2/ une analyse rationnelle qui leur fait dire que cela pourrait marcher et dans le cadre de l’économie à but lucratif, 3/ l’envie d’un retour sur l’épargne qu’ils mettraient à disposition de l’entreprise portant ce projet d’activité.
Le modèle du prêt leur correspond sans doute plus. Pour l’entreprise, l’apport en ressources financières est là, mais la gestion du remboursement, de la rémunération du capital, de la durée d’investissement et du partage de la gouvernance sont réglés par construction. « Je vous prête 100€, sur 5 ans, au taux de 8% par an. Payez et moi et réussissez votre beau projet s’il vous plaît J. »
Bien encadré le modèle de prêt participatif (crowd lending) a sans doute plus de chances de prendre en France. Et il est sans doute un palier intermédiaire nécessaire permettant aux Français de monter en compétence, réduisant ainsi les besoins (et donc coûts) d’intermédiation tout en augmentant l’appétence pour l’investissement participatif en capital (crowd equity) qui garde une légitimité réelle (tout comme la Bourse… J).

Article rédigé par Pierre Frécon
Conseil start-ups sur http://docteur-startup.com
Investisseur professionnel, http://financiere-florentine.fr
[1] Source France TV : http://www.francetvinfo.fr/france/dons-les-francais-sont-genereux_907414.html
[2] Source Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_participatif
[3] Sources : France Angels, AFIC, Chausson Finance